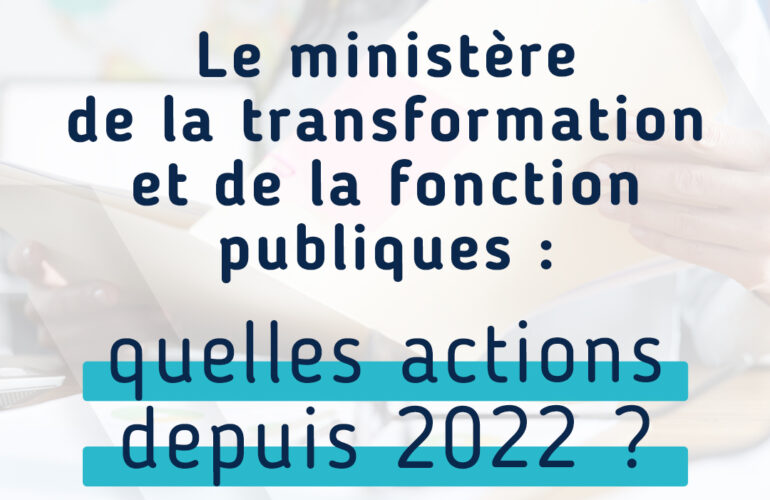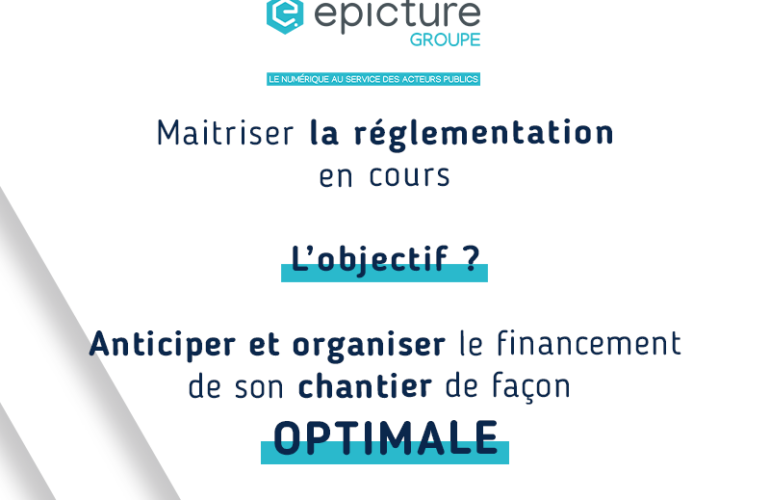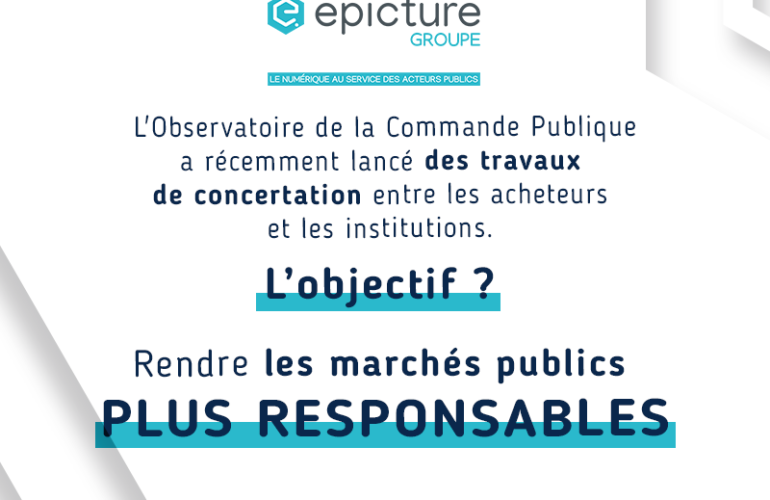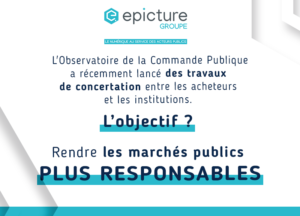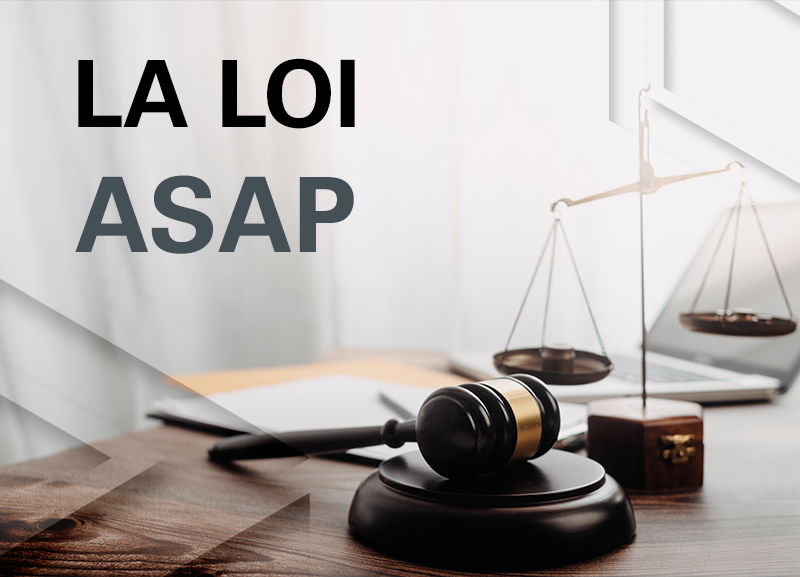Le ministère de la transformation et de la fonction publiques : quelles actions depuis 2022 ?
Chez Epicture, notre objectif est de simplifier et de fluidifier le quotidien des agents publics.
À ce titre, nous suivons de près les actions mises en place par le Ministère de la transformation et de la fonction publiques.
Depuis l’arrivée de Stanislas Guérini en 2022, des évolutions notables ont été mises en place.
à l’heure où le Ministre organise une vaste concertation des agents publics pour comprendre avec précision leurs motivations et leurs attentes, nous vous proposons un bilan des actions réalisées.
Les enjeux du Ministère de la transformation et de la fonction publiques
Le Ministère de la transformation et de la fonction publiques regroupe trois directions :
- la DITP, ou direction interministérielle de la fonction publique. Cette direction regroupe plus de 80 experts pour accompagner les acteurs publics. Son objectif prioritaire : remettre l’usager au cœur des politiques publiques. Dans cette optique, elle anime et coordonne notamment le programme “expérience usager” de l’Etat.
- La DGAFP, ou direction générale de l’administration et de la fonction publique, a pour objectif de centraliser les actions des agents publics et de les accompagner dans la mise en oeuvre de leurs actions RH. Son objectif : construire une fonction publique innovante et mobiliser les acteurs publics pour mettre en place les transformations nécessaires.
- La DINUM, ou direction interministérielle du numérique, est en charge de la transformation numérique de l’Etat. Elle développe notamment les services et ressources partagés. Elle comprend trois départements.
Les actions de la DINUM
La mise en place de la DINUM par décret, en octobre 2019, se concrétise par la création d’une direction de programme et de trois départements bien distincts :
- Tech.gouv est un programme qui a été initié entre 2019 et 2022. L’Etat s’est en effet doté sur cette période d’un programme ambitieux dont l’objectif était d’accélérer la transformation numérique du service public. En mettant en place des actions concrètes, le programme s’est fixé de développer de nouveaux usages et d’accélérer le réflexe du numérique chez les agents et chez les usagers.
- Le département Infrastructures et services opérés est placé sous la responsabilité de Guy Duplaquet, ingénieur général des Mines. Il conçoit notamment le RIE, réseau interministériel de l’Etat. Il permet de rassembler en un seul réseau les réseaux exploités par les différents ministères, qui concernent 17 000 sites ! Ce projet permet une mutualisation de la maintenance et un gain de sécurité.
- Le département Etalab coordonne les gestions des données de l’Etat : il accompagne les institutions de l’Etat pour diffuser largement les informations publiques. Le département simplifie et fluidifie les échanges de données entre administrations. Enfin, il régit la circulation des données dans le plus strict respect des normes RGPD. A travers le programme Lab IA, il facilite l’usage de l’IA par les services publics.
- Le département PSN (performance des services numériques) mène des actions transverses, il pilote les projets relatifs au numérique et soutient leur mise en œuvre.
Quel bilan du Ministère de la transformation et de la fonction publiques en 2023 ?
- Tech Gouv, un ambitieux projet mené à bien.
Intégré à la DINUM, Tech Gouv mobilisait la moitié du budget de la direction et avait donc une lourde responsabilité.
Il répondait à six enjeux identifiés de façon claire :
– simplification,
– inclusion,
– attractivité,
– maîtrise
– économies,
– alliances35 projets agiles ont été menés et mis en place dont l’objectif était de simplifier et de fluidifier l’usage du numérique à destination des agents et des usagers.Des réussites notables ont été observées suite à la mise en place de ce vaste projet : On peut citer notamment le guichet “dites le nous en une fois”, qui permet d’éviter de fournir lors de démarches en ligne des documents déjà présentés à d’autres administrations ; le projet ETNA fournit un “sac à dos numérique de l’agent public” pour doter les agents des outils numériques nécessaires à leur fonction et favoriser la mobilité et le télétravail ; le programme BETA soutenait des start-up d’Etat et de territoire pour les faire gagner en agilité et en efficacité.
- France Services, une nouvelle étape :
le système de guichet unique mis à disposition des Français pour les aider à simplifier leurs formalités administratives connaît un véritable succès. L’objectif des années à venir est de développer les publics et les animateurs France Services pour simplifier les prises de rendez-vous, les démarches …